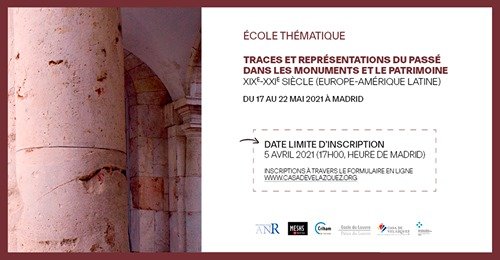 • 17-22 mai 2021
• 17-22 mai 2021
• Madrid, Casa de Velázquez
• Participation : 50 €
sur inscription jusqu’au : 5 avril 2021 par le formulaire en ligne
• Public : doctorants et post-doctorants (5 ans après la date de soutenance)
L’atelier peut être également accessible, au cas par cas, à des mastérants de M2.
Présentation
L’école comprend des conférences historiographiques, méthodologiques ou de recherche d’une part, des ateliers réalisés en groupe restreint d’autre part. Une production scientifique collective sera élaborée par les participants. Les langues de travail sont le français, l’espagnol et l’anglais.
Elle est précédée d’une journée d’étude franco-allemande (17 mai) : tous les participants sont conviés à y assister en présentiel dans la limite des places disponibles (20 participants).
Les traces du passé constituent les buttes-témoins (des témoins) d’événements historiques à jamais révolus : elles rendent présent ce qui appartient au passé et l’incarnent de manière non intentionnelle. Elles sont parfois l’objet d’un réinvestissement symbolique qui les désigne en marques, caractérisées par une signature intentionnelle de la part d’un acteur identifiable. Ce marquage est toujours une forme d’appropriation symbolique et spatiale – a minima, un droit de présence, a maxima, l’affirmation d’une revendication – de la trace matérielle, c’est-à-dire une production de signes.
Les marques produites par les groupes sociaux et les individus sont d’une très grande variété. On peut cependant les regrouper sous deux grands types : les inscriptions graphiques ou imagées, plutôt éphémères et fragiles, et les constructions monumentales, généralement pérennes. Sans exclure les premières, nous nous intéressons ici aux formes durables, en excluant les marquages ne s’opérant pas à partir d’une trace (par exemple, un monument aux morts communal n’a que rarement de lien avec une trace ou un vestige de guerre). Ces interventions relèvent de deux grands types d’opération : la conservation, la monumentalisation et la patrimonialisation de certaines traces d’une part, la démolition ou l’effacement plus ou moins intentionnel d’autres traces d’autre part. Ainsi, patrimonialisation et démolition doivent être pensées de manière dialectique.
Le cadre géographique et temporel retenu recouvre toute l’époque contemporaine (XIXe-XXIe siècle), jusqu’à l’actualité. L’aire étudiée recouvre l’Europe dans un sens large (« de l’Atlantique à l’Oural ») et le monde ibéro-américain dans son ensemble (donc Brésil compris). Les Caraïbes sont également incluses. L’enjeu est ici d’historiciser les usages des traces et des monuments selon les périodes considérées et de les situer dans un contexte local précis afin d’en repérer d’éventuelles singularités. Le jeu des circulations, des imitations dans l’espace euro-américain fera l’objet d’une attention particulière.
L’atelier doctoral s’articule autour des axes suivants :
• La reconnaissance des traces
• Donner sens aux traces
• Représenter le passé
• Transferts et circulation monumentales
• Contre-monuments, anti-monuments
![]()
Informations complémentaires
Contact
Casa de Velazquez
ehehi@casadevelazquez.org